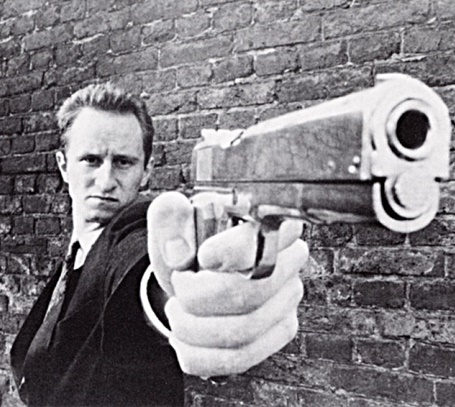CINEMA BELGE
|
Liste des films belge
Années 60-70-80
- Astérix le Gaulois (67: Ray Goossens/F B)
- Astérix et Cléopâtre (68: René Goscinny & Albert Uderzo/F B)
- Un soir, un train (68: André Delvaux/F B)
- Tintin et le temple du soleil (69: Raymond Leblanc/F B)
- Lucky Luke (71: René Goscinny, Morris & Pierre Tchernia/F B)
- Tintin et le lac aux requins (72: Raymond Leblanc/F B)
- La fête à Jules (73: Benoît Lamy/F B)
- Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (75: Chantal Akerman/F B)
- Le chaînon manquant (80: Picha /F B)
- Meurtres à domicile (82: Marc Lobet/F B)
- Dust (85: Marion Hansel/F/B)
- Il y a maldonne (87:John Berry/F B)
Années 90
- Toto le héros (90: J. Van Dornael/F B)
- Hors la vie (91: Maroun Bagdadi/F I B)
- C'est arrivé près de chez vous (92: Remy Belvaux, André Bonzel & Benoît Poelvoorde/B)
- Le fils du requin (92: Agnès Merlet/F B Luxembourg)
- Je pense à vous (92: Luc & Jean Pierre Dardenne/ B)
- Germinal (93: Claude Berri/F B I)
- Farinelli (94: Gérard Corbiau/F I B)
- La vie sexuelle des Belges (94: Jan Bucquoy/B)
- Mécaniques célestes (95: Fina Torres/F-Vénézuela - B - E)
- La promesse (95: Jean-Pierre & Luc Dardenne/B)
- Enfants de salaud (96: Tonie Marshall/F B)
- Le huitième jour (96: Jaco Van Dormael/F B)
- Le jour et la nuit (96: Bernard Henri Lévy/F C B E)
- Un divan à New York (96: Chantal Akerman/F D B)
- Ma vie en rose (97: Alain Berliner/F B)
- Pour rire ! (97: Lucas Belvaux/F B)
- La patinoire (98: Jean-Philippe Toussaint/B)
- Train de vie (98:Radu Mihaileanu/F B NL)
- Deuxième quinzaine de juillet (99: Christopher Reichert/F B)
- Les convoyeurs attendent (99: Benoît Mariage/B)
- Rosetta (99: Jean-Pierre & Luc Dardenne/F B)
- Une liaison pornographique (99: Frédéric Fonteyne/F B)
Années 00
|
|
A n n é e s 0 0 |
Années 10
|
|
A n n é e s 1 0
A n n é e s 1 0 |
Années 20
- Cette musique ne joue pour personne (20: Samuel Benchetrit/F B)
- Filles de joie (20: Frédéric Fonteyne & Anne Paulicevich/F B)
- Jumbo (20: Zoé Wittock/B F Luxembourg)
- Sons of Philadelphia (20: Jérémie Guez/USA F B Pays Bas)
- La terre et le sang (20: Julien Leclercq/F B)
- Une vie démente (20: Ann Sirot & Raphaël Balboni/B)
- Villa Caprice (20: Bernard Stora/F B)
- Dune dreams (21: Samuel Doux/F B)
- Entre la vie et la mort (21: Giordano Gederlini/B F E)
- Fils de plouc (21: Harpo & Lenny Guit/B)
- Plongée mortelle (21: Hans Herbots/B)
- The replacement (21: Óscar Aibar/E B)
- Titane (21: Julia Ducournau/F B)
- Bowling Saturne (22: Patricia Mazuy/F B)
- Les Cyclades (22: Marc Fitoussi/F B Grèce)
- Les harkis (22: Philippe Faucon/F B)
- Les huit montagnes (22: Felix Van Groeningen & Charlotte Vandermeersch/F I B)
- La ligne (22: Ursula Meier/Suisse F B)
- La maison (22: Anissa Bonnefont/F B)
- Normale (22: Olivier Babinet/F B)
- R.M.N. (22: Cristian Mungiu/F B Roumanie)
- L'étoile filante (23: Dominique Abel & Fiona Gordon/F B)
- Sur la branche (23: Marie Garel-Weiss/F B)
- Les trois mousquetaires: D'Artagnan (23: Martin Bourboulon/F D E B)
- La vie pour de vrai (23: Dany Boon/F B)